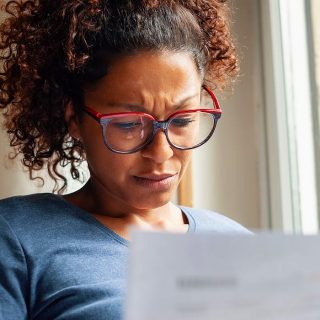Ce qu'il faut retenir :
01
02
03
04
En amont de toute assignation en justice, ou de toute procédure d’exécution forcée, il est possible pour un débiteur en difficulté de demander au juge l’octroi d’un délai de grâce afin d’éviter d’aggraver son insolvabilité, ou encore dans le but d’obtenir du temps pour organiser son départ des lieux. En effet, les demandes de délais peuvent intervenir dans deux hypothèses ; le paiement d’une créance ou le départ des lieux dans le cadre d’une procédure d’expulsion. S’agissant de la première conjecture, l’article 1343-5 alinéa premier dispose en l’espèce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Pour ce qui est de la seconde conjecture, conformément aux articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut notamment, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, proroger le délai jusqu’à 3 mois dès lors que la procédure entraine d’abondantes difficultés.
En principe, l’octroi d’un délai de grâce peut se faire par différents juges, mais en matière d’exécution forcée, seul le juge de l’exécution est compétent. En effet, l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ainsi, il convient de s’en remettre à ce magistrat dès lors qu’a été délivré un commandement ou tout autre acte de saisie, lequel magistrat pourra alors fixer de nouvelles modalités de paiement, retirer toute majoration et intérêts de retard, ou encore suspendre les paiements sur une période de 2 ans, sous réserve des hypothèses dans lesquelles l’octroi d’un délai est exclu.
L’intérêt de la demande de délai
L’intérêt d’une telle demande tient en premier lieu de ce qu’elle est démonstrative de la bonne foi du débiteur. Également, le fait que le juge acquiesce à la demande n’emporte pas pour autant inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers [FICP], ce qui peut être opportun puisqu’il peut être consulté jusqu’à 5 ans par les établissements de crédit et les sociétés de financement et de tiers financement. Également, puisqu’il s’agit là de l’essence même du délai de grâce, dès à partir de l’octroi de celui-ci par le juge de l’exécution, toutes les mesures d’exécution sont suspendues jusqu’au terme du délai accordé ; aucun Commissaire de justice ne peut continuer la procédure en cette période de protection. En revanche, à cela il importe de préciser que l’article 513 du Code de procédure civile dispose : « Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires ».
La procédure à suivre
Il importe avant tout au créancier d’effectuer une mise en demeure de payer à son débiteur, ou de lui faire délivrer un commandement de payer. A partir de ce moment, le débiteur pourra alors saisir le juge de l’exécution. A cela, il importe de préciser que la demande peut porter sur des difficultés futures en ce qu’il n’est pas nécessaire que des défauts de paiement aient déjà eu lieu, le délai de grâce peut être l’anticipation d’une insolvabilité. Par suite, pour que le juge de l’exécution accorde le délai de grâce, il convient de lui présenter sa bonne foi – proposer un règlement partiel immédiat est opportun –, les raisons d’une telle demande, tout en lui précisant que ces difficultés sont temporaires et résultent de circonstances particulières et ce, par la présentation de différents justificatifs appuyant la demande. En revanche, si le demandeur est débiteur de différentes créances, il lui faudra effectuer une demande de délai pour chacune d’entre elles. En cas de refus, le juge doit motiver sa décision.