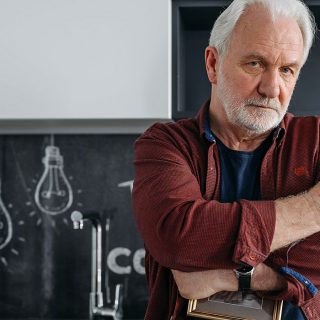Ce qu'il faut retenir :
01
02
La convocation à l’entretien préalable doit se faire par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou par remise en main propre.
03
L’entretien préalable doit intervenir au plus tôt cinq jours ouvrables suivant la remise de
la notification.
04
Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel
de l’entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité
administrative.
L’article L. 1232-2 du Code du travail dispose, en son alinéa premier : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ». Dès lors, il apparait que le législateur a fait le choix d’ériger l’entretien préalable en tant qu’étape indispensable de la procédure de licenciement. Pour cause, c’est notamment lors de cet entretien que le principe du contradictoire est respecté en ce que les intéressés y échangent successivement leurs motifs, arguments et explications, conformément à l’article L. 1232-3 du Code du travail.
L’intérêt de la présence de l’huissier de justice lors de l’entretien préalable
A défaut de répondre aux exigences législatives, la procédure de licenciement devient irrégulière. Dès lors, il est des cas dans lesquels l’intervention d’un Commissaire de justice est des plus opportuns aux fins de sécuriser la procédure face à un salarié de mauvaise foi. En effet, il est de principe que la convocation à l’entretien préalable doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en main propre, conformément à l’article L. 1232-2 du Code du travail. Toutefois, encore faut-il que le destinataire de l’acte accepte de signer l’accusé de réception ou de recevoir entre ses mains l’acte litigieux. C’est à défaut d’une telle hypothèse que l’appel à un Commissaire de justice est vivement recommandé. Par ailleurs, cette position est partagée par la chambre sociale de la Cour de cassation elle-même qui, en 2012 a admis que, si les circonstances l’exigent, la convocation à l’entretient préalable peut être signifiée par voie de Commissaire de justice, sous réserve toutefois d’un devoir de discrétion de la part de ce dernier. En revanche, il apparait pour l’heure qu’un tel procédé se veut être subsidiaire, l’employeur ne pourra en user qu’en cas de défaillance des modes de remise traditionnels.
En outre, il importe de considérer que la remise d’un document par un officier public et ministériel fait foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors, en choisissant les services d’un huissier de justice, l’employeur se constitue pleine preuve de la notification de la convocation à l’entretien préalable, comme si le destinataire de l’acte n’avait pas été de mauvaise foi.
La procédure à suivre
En cas de licenciement, l’employeur doit convoquer son salarié à l’entretien préalable, lequel entretient doit intervenir au plus tôt cinq jours ouvrables suivant la remise de la notification. Lorsque l’employeur souhaite davantage sécuriser la procédure, ce dernier mandate un Commissaire de justice. En effet, la date de notification sera précisément déterminée, ce qui facilitera par la même le respect du calendrier imposé par le législateur en la matière, à la différence de la lettre recommandée dont la date de réception peut présenter des incertitudes. Le non-respect du formalisme législatif ne pourra donc pas être invoqué par le salarié aux fins de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
Également, l’article L. 1232-4 du Code du travail dispose notamment : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative ». En revanche, en aucun cas un Commissaire de justice ne peut assister le salarié lors de l’entretien préalable, ni même être présent pour effectuer un constat, le rôle de se professionnel se limite en la matière à la notification de la convocation puis par suite, de la lettre de licenciement s’il en est mandaté.