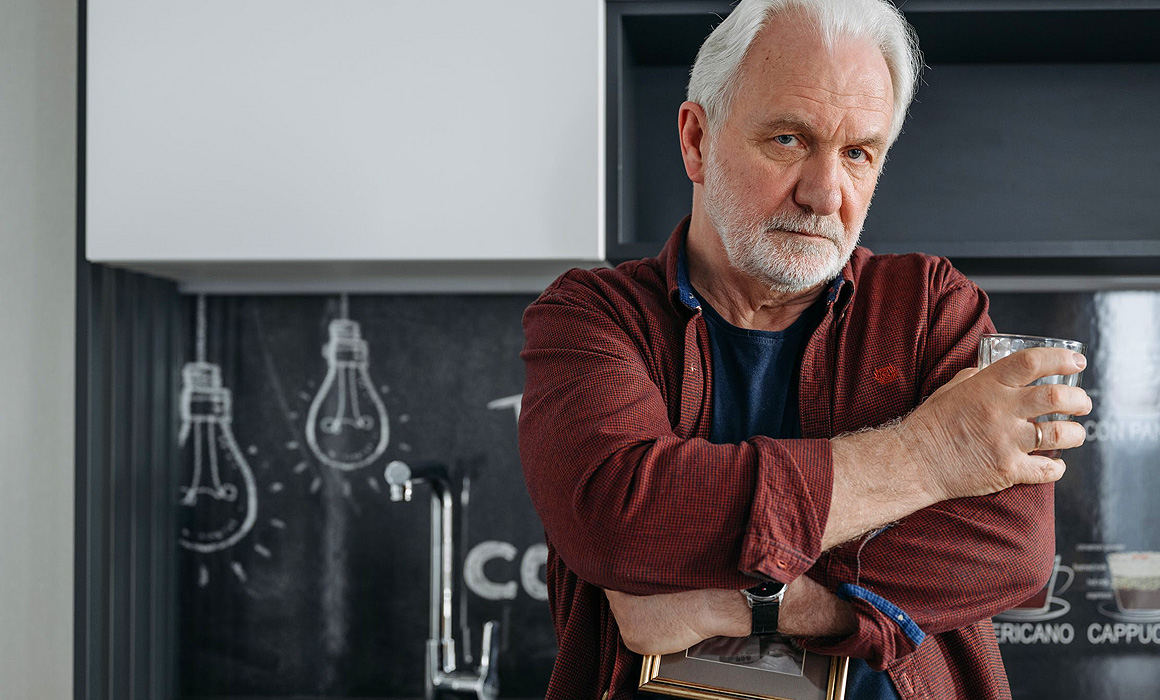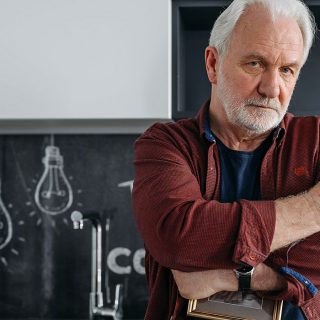Les actions concurrentielles ne sont pas prohibées par le Code de commerce, notamment en ce qu’elles permettent d’accroitre l’économie par le biais d’innovations commerciales. En effet, au sein de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 relative à l’orientation du commerce et de l’artisanat, l’article 1 dispose en son premier alinéa : « La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale ». Pour autant, afin de répondre à cette obligation de concurrence claire et loyale, encore faut-il être en mesure de délimiter la notion de concurrence déloyale. En conséquence, il est de principe de considérer comme déloyal l’ensemble des pratiques commerciales préjudiciables pour une entreprise concurrente autre que celle qui en use. Traditionnellement, quatre pratiques sont assimilées à des cas de concurrence déloyale ; le dénigrement par discrédit d’une entreprise concurrente, l’imitation par l’instauration d’une confusion avec l’entreprise concurrente, la désorganisation par manœuvres prohibées, et le parasitisme par profit illégitime des efforts d’un concurrent. Ainsi à titre illustratif, est considéré comme déloyal le fait d’avoir recours à de la publicité mensongère et trompeuse, celui de révéler un secret de fabrication, ou encore celui de détourner la clientèle. Pour autant, il convient de préciser que pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la qualification de la concurrence déloyale suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité. Dès lors, à défaut de la réunion de ces trois éléments, aucune responsabilité ne pourra être engagée.
L’intérêt du constat de concurrence déloyale
L’intérêt du constat de concurrence déloyale est en premier lieu probatoire. En effet, le Commissaire de justice requis aux fins de constatations va recueillir la preuve du comportement fautif de l’entreprise à l’égard de son concurrent. Le dénouement du procès dépendant principalement des preuves que les parties apportent au soutien de leurs prétentions, la production d’un procès-verbal de constat est un élément bien souvent déterminant pour emporter la conviction du juge et par la même, faire valoir ses droits. En effet, du fait du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les magistrats sont bien souvent exigeants s’agissant des preuves recevables en la matière. Un élément de preuve émanant d’un officier public et ministériel est alors des plus opportuns.
La procédure à suivre
Le Commissaire de justice peut être requis à deux escients. Dans la première hypothèse, celui-ci intervient pour le compte de la société soupçonnée de pratiques déloyales, afin qu’il constate le défaut de fondement de telles rumeurs. A l’inverse, dans une seconde hypothèse, le Commissaire de justice peut être requis pour intervenir par surprise dans une entreprise concurrente, notamment pour empêcher la destruction éventuelle de preuves. En revanche, dans une telle situation, il importe d’obtenir l’autorisation du juge des référés compétent, saisi par voie de requête motivée. Dans tous les cas, le Commissaire de justice devra constater objectivement ce qu’il convient de constater, sans outrepasser ses fonctions. Enfin, il importe de préciser que, conformément à l’article 110-4 du Code de commerce, un délai de prescription quinquennale s’applique en la matière à compter du jour où la pratique déloyale a cessé. La réparation du préjudice sera prononcée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et la cessation des pratique litigieuses sera ordonnée, au besoin sous peine d’astreinte, conformément aux articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.