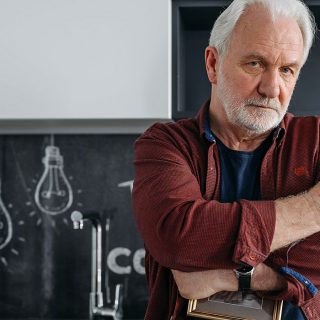Ce qu'il faut retenir :
01
02
03
Le droit de grève a une valeur constitutionnelle en raison du préambule de la
Constitution de la IV République : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent ».
04
05
Sous son acception des plus larges, la grève correspond à un mouvement collectif, initié par le personnel d’une entreprise, et destiné à exprimer des revendications sociales, économiques, voire politiques, à l’employeur. En France, le droit de grève dispose d’une valeur constitutionnelle, conférant par la même une véritable protection à ceux qui en usent. Toutefois, pour qu’une telle protection soit effective, encore faut-il que la grève soit considérée licite. A cela, la Cour de cassation considère comme nécessaire la réunion de trois critères : un mouvement de grève collectif et concerté, une cessation totale de travail, et l’existence de revendications professionnelles.
L’intérêt du constat de grève
Lorsque l’exercice du droit de grève se veut être excessif, abusif, ou en contradiction avec la
législation qui l’encadre, l’employeur peut avoir intérêt à faire constater, par un Commissaire
de justice, la non-conformité du mouvement engendré, voire les dommages qui y sont inhérents.
A l’inverse, il peut également être opportun, pour le personnel de l’entreprise lui-même, de faire
procéder à un procès-verbal de constat aux fins d’établir un exercice du droit de grève en toute
licéité, par anticipation notamment à un éventuel litige s’il y a lieu.
Le constat a un intérêt probatoire évident en ce qu’il fait foi, en matière civile, jusqu’à preuve
contraire. En effet, rédigé par un officiel public et ministériel, sa production lors d’un procès
constitue un élément déterminant permettant de prouver l’infraction et par suite, emporter la
conviction du juge.
Relativement au droit de grève toujours, le constat est un moyen efficace pour justifier
légitimement des négociations, ou simplement servir les intérêts en présence. En effet par
exemple, dès lors que le professionnel ne constate aucun abus dans l’exercice du droit de grève,
les grévistes bénéficient de la protection qui leur est due. Autre illustration pour un intérêt aux
antipodes, l’employeur peut avoir intérêt à faire constater par le Commissaire de justice la commission d’une faute lourde de la part des grévistes, permettant par la même le
déclenchement d’une procédure disciplinaire, voire la rupture du contrat de travail en cours.
La procédure à suivre
Lorsque le constat a été requis par l’employeur, aucune obligation d’information préalable des
salariés n’est établie. Une fois arrivé sur les lieux requis, le Commissaire de justice chargé du
constat a l’obligation de décliner son identité et sa qualité et l’objet de sa visite. Par suite, le
professionnel doit relever l’identité de chacun des grévistes. En revanche, celui-ci ne peut
requérir de la part des intéressés la présentation d’un justificatif d’identité, et aucune obligation
de décliner son identité ne pèse sur ces derniers. En outre, le Commissaire de justice constate
objectivement le comportement des grévistes, ainsi que l’accès au lieu de travail laissé aux non-
grévistes ; un accès restreint étant constitutif d’une faute lourde. Pour effectuer ses constatations, le Commissaire de justice est autorisé à prendre photographies et vidéographies.
Le constat de grève sera par suite remis dans les plus brefs délais au requérant, sur support
papier ou par voie électronique.
Actualités (Mise à jour 2023)
Dans un récent arrêt du 1er juin 2023 (n° 22-13.304), la chambre sociale de la Cour de cassation
est venue délimiter le régime du droit de grève ainsi que celui du licenciement y afférant : « La
nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé
pour avoir participé à une grève mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait
commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut être qualifié de
faute lourde. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes,
l’arrêt retient que si un mouvement de grève a eu lieu le 2 juillet 2014, lequel a fait l’objet d’un
préavis communiqué à l’employeur le 30 juin 2014, il n’est pas justifié que le salarié, qui
soutient avoir été gréviste dans le cadre de ce mouvement, a cessé son travail plusieurs heures
avant le déclenchement de la grève qui a été déclarée le 2 juillet 2014 en fin d’après-midi à
l’issue de la réunion qui s’est tenue entre la direction et les représentants du personnel [..].
L’arrêt retient encore que les faits reprochés au salarié résultaient d’un conflit propre avec sa
direction et que c’est de façon purement opportune que ce dernier a prétendu avoir été en grève
le 2 juillet 2014 alors par ailleurs qu’il ne s’était pas déclaré gréviste et qu’il avait utilisé le
système de pointage des entrées et des sorties du personnel le 2 juillet ainsi que le lendemain,
date de sa mise à pied conservatoire, sans qu’il se prévale du mouvement de grève alors en
cours. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la lettre de licenciement
reprochait au salarié d’avoir incité ses collègues à faire grève, ce dont il résultait que le
licenciement avait pour partie été prononcé à l’occasion de l’exercice du droit de grève, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ». Par conséquent, le fait d’inciter ses collègues à faire grève se
rattache à l’exercice régulier du droit de grève et ne peut justifier, même en partie, le
licenciement d’un salarié.