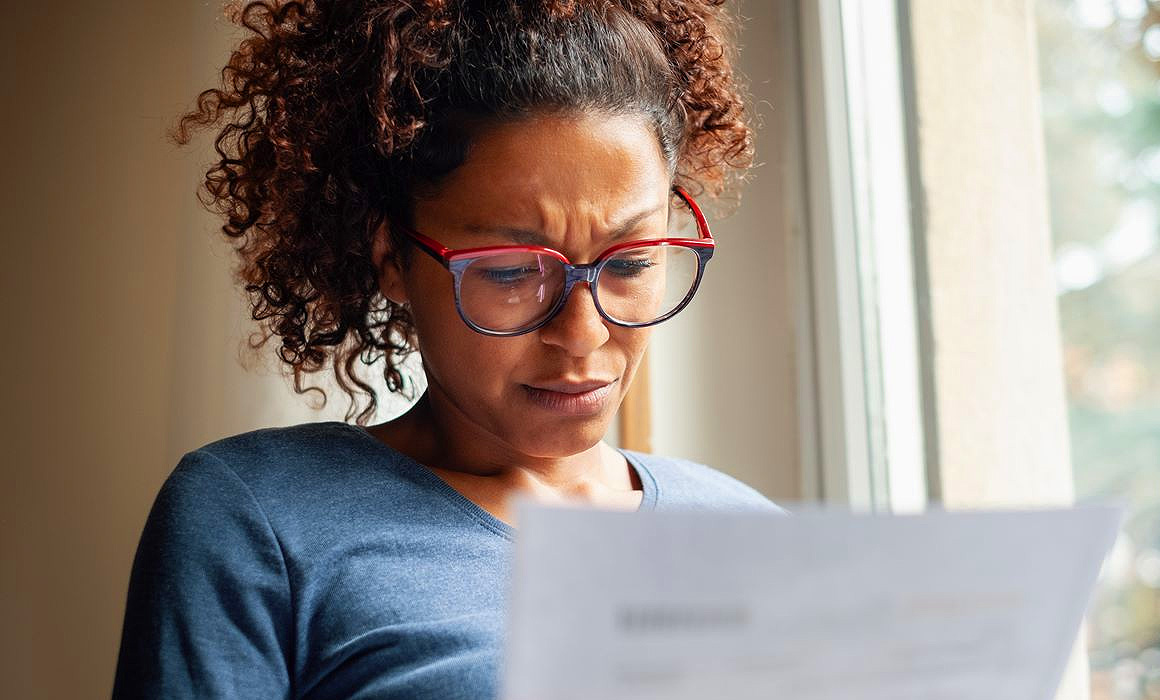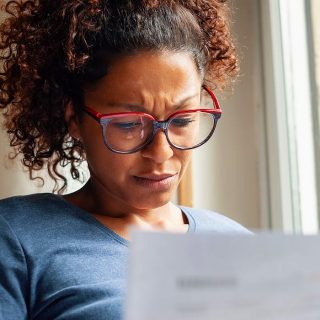Ce qu'il faut retenir :
01
Les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de
permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou
partie du patrimoine du débiteur.
02
Lorsque la saisie conservatoire est pratiquée, les biens du débiteur objet de la saisie sont
rendus indisponibles ; toute cession ou aliénation du bien saisi est prohibée.
03
2 conditions pour qu’une saisie conservatoire soit pratiquée : il faut une créance fondée
en son principe, et des circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement.
04
La saisie conservatoire n’a pas à être précédée d’un commandement de payer ou d’une sommation, elle peut être pratiquée par surprise ce qui empêche le débiteur d’organiser
son insolvabilité.
Définition
Par principe, les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de
permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du
patrimoine du débiteur. Il s’agit donc de véritables garanties utilisées à titre préventif contre
l’organisation de l’insolvabilité de celui-ci. A cela, l’article L. 511-1 du Code des procédures
civiles d’exécution dispose en son second alinéa : « La mesure conservatoire prend la forme
d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». Ainsi, il apparait que la saisie
conservatoire n’est qu’une catégorie de mesure conservatoire, une catégorie réservée aux biens
mobiliers corporels et incorporels, contrairement aux sûretés judiciaires qui elles, sont utilisées
pour les biens immobiliers. A cela, il importe de préciser que la saisie conservatoire de droit
commun est régulièrement ouverte également sur les biens meubles du débiteur ayant déjà fait
l’objet d’une telle saisie antérieurement.
L’intérêt de la saisie conservatoire
Lorsque la saisie conservatoire est autorisée par le juge de l’exécution – ou lorsqu’une
autorisation n’est pas nécessaire si le créancier est d’ores et déjà en possession d’un titre
exécutoire ou si le défaut de paiement provient d’une lettre de change acceptée, d’un billet à
ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé –, les biens du débiteur objet de la saisie
conservatoire sont rendus indisponibles – sauf à ce qu’ils soient déclarés insaisissables en raison
de la loi ou d’une convention –. Ainsi, la saisie conservatoire tient son intérêt de ce que le
débiteur ne disposera plus de l’abusus sur son bien mais en deviendra simple gardien ; toute
cession ou aliénation du bien saisi est prohibée.
L’autre intérêt primordial de la saisie conservatoire n’est autre que l’effet de surprise qu’elle
génère. En effet, à la différence de la mesure d’exécution qu’est la saisie-vente, la saisie
conservatoire n’a pas à être précédée d’un commandement de payer ou d’une sommation. Ainsi,
comme le créancier peut la mettre en œuvre quand il le souhaite – sous un délai de 3 mois du
moins à compter de l’autorisation du juge –, le débiteur ne peut pas organiser son insolvabilité
en se séparant de quelques biens.
Enfin, les biens du débiteur étant bloqués dans le patrimoine en raison de la saisie conservatoire
qui pèse sur eux, les créanciers ayant pratiqué cette mesure sont certains de voir recouvrer leur
créance quoi qu’il en soit. En effet, à défaut de paiement par le débiteur, ceux-ci pourront alors
convertir la saisie conservatoire en saisie-vente et obtenir satisfaction sur le produit de la vente
du bien saisi.
La procédure à suivre
Pour qu’une saisie conservatoire soit autorisée par le juge de l’exécution, encore faut-il qu’elle
remplisse 2 conditions. En effet, le premier alinéa de l’article L. 511-1 du Code des procédures
civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe
peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son
débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en
menacer le recouvrement ». Ainsi, il importe dans un premier temps que la créance paraisse
fondée dans son principe. A ce titre, peu importe la nature de cette dernière tant qu’il s’agit d’une créance somme d’argent – sauf pour la saisie revendication –. Également, à la lecture de
la disposition précitée, il convient pour le créancier de prouver qu’il existe des circonstances
susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Une fois ces deux conditions réunies,
le créancier doit par principe déposer une requête aux fins d’autorisation préalable devant le
juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur – voire devant le président du tribunal de
commerce si la créance est commerciale et que la requête est faite avant tout procès –. A préciser
que le dépôt d’une requête n’est pas exigé lorsque le créancier est porteur d’un titre exécutoire,
d’un titre cambiaire impayé ou d’un chèque impayé, voire d’un bail d’immeuble écrit pour des
loyers impayés. A ce dépôt, le juge pourra soit autoriser la demande – mais dans ce cas
l’ordonnance doit fixer le montant de la somme pour lequel la saisie est autorisée –, soit en
accepter une partie seulement, ou soit rejeter la requête déposée. Une fois l’autorisation
obtenue, le Commissaire de justice dispose d’un délai de 3 mois pour effectuer la saisie
conservatoire, laquelle devra être portée à la connaissance du débiteur sauf si elle est faite
directement entre ses mains – à défaut il faut la dénoncer sous 8 jours au débiteur –. Par suite,
il convient d’engager, à compter de la saisie conservatoire, une procédure sous 1 mois aux fins
d’obtenir un titre exécutoire. A ce stade, le créancier pourra alors convertir le saisie
conservatoire en saisie-vente ou saisie-attribution.
Actualités (mise à jour 2025)
La question de l’intérêt a agir pour une contestation de saisie conservatoire a récemment été
tranchée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 Juin 2023
(n° 19-11.732) : « Dès lors qu’elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de
nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est
pratiquée a un intérêt à la contester. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société
Montana, l’arrêt retient que dans ses écritures, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire,
la société Montana soutient ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures
conservatoires et que bien que son intérêt à agir soit contesté par l’appelante, elle ne précise
pas à quel titre elle serait, dès lors, fondée à poursuivre la mainlevée de ces mesures, le seul
fait qu’il soit mentionné dans les procès-verbaux des mesures conservatoires que ces mesures
portent sur les fonds de la société Montana, dont la saisissante estime qu’ils appartiennent à
l’État d’Irak, ne saurait lui reconnaître un intérêt à agir. En statuant ainsi, alors que la société
Montana figurait dans les actes de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire,
la cour d’appel, qui ne pouvait qu’en déduire que cette société avait un intérêt à contester ces
mesures, a violé les textes susvisés ». Dès lors, à partir du moment où elle est visée dans l’acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de
laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.